Parentalité
Le désir de parentalité est une expérience profondément personnelle. Il ne s’impose pas comme une norme ou une étape obligatoire dans la vie d’un couple ou d’un individu. Mais, pour les couples LGBTQIA+ et plus précisément les FSF souhaitant donner vie à ce projet, le parcours vers la maternité peut prendre des formes particulières, tant sur le plan médical que juridique ou administratif.
En Belgique, différentes options existent pour envisager une parentalité en accord avec tes valeurs, ta situation et tes aspirations.
LA PROCRÉATION MÉDICALEMENT ASSISTÉE (PMA)
La procréation médicalement assistée (PMA), sous diverses formes, a toujours existé comme réponse aux problèmes de fertilité des couples. Cependant, grâce à l’évolution des techniques et des mentalités, son accès s’est progressivement élargi. Historiquement, la PMA se limitait à des méthodes rudimentaires, comme l’insémination, sans préparation, souvent douloureuses et risquées.
Aujourd’hui, les progrès scientifiques s’accompagnent d’une évolution des discours sociétaux, permettant notamment aux couples lesbiens de bénéficier de ces méthodes pour réaliser leur projet parental. Grâce à ces changements, la PMA n’est plus uniquement perçue comme un remède à l’infertilité, mais comme un moyen d’accéder à la parentalité pour toutes les familles.
La PMA est une option ouverte à toutes les personnes désireuses de devenir parents, quels que soient leur sexe, genre, origine, situation familiale ou attirances romantiques et/ou sexuelles. Que vous soyez célibataire, en couple, marié·e ou en union libre, cette possibilité vous est accessible. Cependant, le parcours peut se révéler complexe, notamment en raison des différences légales et culturelles d’un pays à l’autre. En Belgique, depuis 2007, la loi garantit l’accès à la PMA pour tous les couples, y compris les couples lesbiens, dans un cadre juridique inclusif¹.
Il est important de bien choisir le centre dans lequel est réalisée la PMA car la procédure est longue et implique de nombreuses visites au centre. La première visite sert généralement à aborder le projet de parentalité dans son ensemble. Ensuite, un entretien est prévu chez la psychologue. Ces multiples entretiens peuvent sembler injustes, mais ceux-ci sont appliqués à toute personne faisant une demande de PMA.
Soutien psychologique
S’engager dans un traitement de PMA est une étape importante et souvent éprouvante, tant sur le plan physique qu’émotionnel. Il se peut que tout le processus prenne du temps. Les examens et traitements médicaux peuvent être vécus comme invasifs, fatigants ou douloureux. L’incertitude du résultat est également une source de stress importante, rendant les hauts et les bas émotionnels fréquents, que ce soit individuellement ou en couple. C’est pourquoi un soutien psychologique est proposé.
Filiation et droits de l’enfant issu d’une PMA
Pour toutes les questions relatives à la filiation, il faut savoir qu’en Belgique, la loi du 5 mai 2014 permet d’établir une filiation directe pour le/la deuxième coparent·e lors d’un recours à la PMA, sans passer par une procédure d’adoption. Les démarches pour établir la filiation sont les mêmes pour les couples de même sexe que pour les couples hétérosexuels. Si les deux parents sont marié·es, celui ou celle qui n’a pas porté l’enfant sera automatiquement reconnu·e comme coparent·e légal·e.
Pour les couples non marié·es, la partenaire qui n’a pas contribué avec ses gamètes pourra reconnaître l’enfant, tout comme les couples hétérosexuels².
Plusieurs techniques de PMA sont disponibles pour répondre aux besoins spécifiques des personnes ou des couples :
L’insémination artificielle ou insémination intra-utérine
L’insémination artificielle ou intra-utérine est une méthode accessible de procréation médicalement assistée.
Elle consiste à placer des spermatozoïdes directement dans l’utérus pour maximiser les chances de grossesse.
Voici l’essentiel :
Encadrée médicalement, elle utilise un échantillon de sperme (donneur ou partenaire) préparé et injecté via un cathéter
dans l’utérus, elle peut parfois être accompagnée d’une légère stimulation ovarienne pour améliorer les chances de fécondation.
Nous vous invitons à vous référer au site de la CHC Groupe Santé, si vous souhaitez en savoir plus :
La Fécondation In Vitro (FIV)
La FIV est une option plus complexe mais tout aussi efficace.
Elle s’adresse aux couples avec des difficultés d’ovulation, d’implantation, nécessitant un don ou voulant utiliser la méthode ROPA (Réception Ovocyte par Partenaire).
Il existe plusieurs méthodes possibles pour réaliser une FIV :
- utilisation des ovules de l’une des partenaires du couple,
- utilisation d’un don d’ovocytes, et/ou du sperme d’un donneur.
- Par ailleurs, la méthode ROPA – Réception d’Ovocytes de la Partenaire – permet à l’une d’être la mère génétique et l’autre, la mère gestante.
Ensuite, il s’agit d’un processus précis et ordonné³ :
- Stimulation des ovaires grâce à des traitements hormonaux.
- Prélèvement des ovocytes, ce qui se fait sous anesthésie.
- Fécondation des ovocytes en laboratoire avec le sperme soit du/de la partenaire, soit d’un donneur.
- Culture embryonnaire : les ovocytes fécondés avec le sperme, appelés alors embryons, sont cultivés pendant 3 à 6 jours.
- Transfert dans l’utérus d’un ou deux embryons, via un cathéter indolore. Les embryons restants peuvent être congelés pour plus tard.
- Test de grossesse après une dizaine de jours.
Nous vous invitons à vous référer au site de la CHC Groupe Santé, si vous souhaitez en savoir plus :
Le Don de Sperme
Le don de sperme, bien qu’associé aux techniques de procréation médicalement assistée, n’est pas en soi une méthode de PMA. Il constitue plutôt un moyen parmi d’autres d’accéder à la parentalité.
Méthodes disponibles : Insémination intra-utérine (IIU) ou Fécondation In Vitro (FIV).
- En Belgique : Accessible aux couples lesbiennes, avec possibilité de choisir un donneur anonyme ou connu, en accord direct.
- Choix du donneur : Basé sur des critères phénotypiques pour favoriser une harmonie familiale.
En Belgique, le don de sperme est strictement encadré pour garantir une filiation claire,
en évitant toute revendication future du donneur, et pour prévenir les risques de consanguinité
en limitant le nombre de dons par donneur. La législation interdit également toute commercialisation du sperme
afin de préserver une démarche altruiste, éthique et respectueuse des droits de chacun.
LA COPARENTALITÉ
Cette méthode est l’association de plusieurs coparents dans un projet familial commun qui dépasse la plupart du temps le cadre du couple.
La coparentalité peut se présenter sous diverses configurations : il pourrait s’agir d’un couple de lesbiennes qui décident de faire un enfant avec une personne gay ou hétérosexuelle, en couple ou non, et, à l’inverse, un couple gay qui s’associerait avec une femme lesbienne ou hétérosexeuelle, en couple ou non.
Cette méthode, consiste en un contrat entre deux personnes qui établissent des règles sur le partage de l’autorité parentale et du droit de garde. La famille va alors se composer de deux, trois ou quatre parents : deux parents biologiques et des partenaires qui vont s’engager vis-à-vis de l’enfant dès sa conception. Ceux-ci n’auront pas le statut de “parent” mais celui de “co-parent”.
Il est conseillé de se rendre chez une notaire pour ce type de procédure afin d’officialiser le contrat, de poser le cadre délimitant les rôles et les interventions de chacun·e dans la vie de l’enfant (pensions alimentaires, tours de garde, rythme de vie, choix scolaires…). Tout peut être revu et remis en question devant la juge de la famille dans l’intérêt de l’enfant.
Par ailleurs, chaque situation de coparentalité aura ses propres spécificités. On vous conseille de vous faire accompagner par des personnes spécialisées dans le domaine.
LA GESTATION POUR AUTRUI (GPA)
La GPA⁴ est une autre solution pour accéder à la parentalité où une personne gestatrice accepte de porter un enfant pour un couple appelé les parents d’intention. En Belgique, bien que la GPA ne soit pas légalement encadrée, elle est tolérée sous certaines conditions strictes, définies par les établissements.
Types de GPA
- GPA traditionnelle : La gestatrice fournit également ses ovocytes, devenant ainsi la mère génétique de l’enfant.
- GPA complète : Un embryon distinct (issu des gamètes des parents d’intention ou de donneur·euses) est implanté, sans lien génétique avec la gestatrice.
Conditions pour la gestatrice :
- Moins de 40 ans et en bonne santé.
- Avoir déjà eu un enfant.
- Être proche des parents d’intention (famille ou amie).
- Accepter sans compensation financière autre que les frais médicaux.
Étapes clés
- Encadrement juridique et psychologique : Consultation avec un·e juriste et des psychologues pour clarifier les aspects légaux et émotionnels.
- Sélection médicale : Évaluation stricte des parents et de la gestatrice.
- Décision et suivi médical : Une fois approuvé, le processus démarre sous supervision médicale rigoureuse.
Pour les couples lesbiens, un embryon peut être conçu à partir des ovocytes de l’un·e des partenaires, avec du sperme de donneur.
La GPA est une démarche complexe mais possible en Belgique dans des centres spécialisés comme ceux de :
Par ailleurs, n’hésite pas à contacter un avocat ou un juriste pour obtenir plus de renseignements. En outre, si vous avez recours à une GPA faite à l’étranger, vérifiez avant la procédure et les démarches afin de pouvoir accueillir l’enfant en Belgique.
L’ADOPTION
En Belgique, depuis la loi du 18 mai 2006, l’adoption est accessible à toutes les familles, qu’elles soient monoparentales, composées de couples mariés, cohabitant·es légaux, ou uni·es par tout autre type de relation, peu importe leurs attirances romantiques et/ou sexuelles. Cela signifie que les couples lesbiens ont également le droit d’adopter, offrant ainsi une voie précieuse pour fonder une famille.
L’adoption peut se faire de deux façons :
- L’adoption interne, qui concerne l’adoption d’un·e enfant vivant en Belgique par une ou plusieurs personnes résidant également en Belgique.
- L’adoption internationale, qui consiste à accueillir un·e enfant venu·e de l’étranger, soit après que l’adoption ait été validée dans son pays d’origine, soit dans le cadre d’un placement pré-adoptif avant une décision finale en Belgique.
Adoption Interne : Pour les couples et personnes vivant en Belgique
L’adoption interne⁵ est un processus qui inclut des options pour adopter un·e enfant mineur·e ou majeur·e. En fonction du type d’adoption choisi (simple ou plénière), différents droits et obligations juridiques seront établis entre l’adopté·e, l’adoptant·e et leurs familles respectives.
Conditions pour adopter :
- Il faut avoir au moins 25 ans ;
- Il faut avoir au moins 15 ans de plus que l’enfant qu’on veut adopter (Si vous adoptez l’enfant de votre partenaire, cet écart est réduit à 10 ans) ;
- L’enfant ne doit ni avoir de filiation maternelle et/ou de filiation paternelle, si c’est le cas l’autre partie (père ou mère) doit avoir renoncer soit même à ces droits parentaux ou avoir été déchu de ces droits par un juge ;
- Le/la conjoint·e ou cohabitant·e de l’adoptant·e doit consentir à l’adoption ;
- Être jugé·e apte et qualifié·e par le tribunal de la jeunesse, en disposant des qualités socio-psychologiques nécessaires.
Nous vous invitons à vous référer au site du Service Public Fédéral Justice, si vous souhaitez en savoir plus sur l’adoption interne :
Adoption Internationale
Pour une adoption à l’étranger⁶, au-delà de la législation belge, le droit du pays d’origine doit également avoir accepté l’adoption par des personnes du même sexe.
Nous vous invitons à vous référer à la brochure produite par le SPF Justice, si vous souhaitez avoir les détails des différentes étapes de l’adoption internationale :
FAMILLE D’ACCUEIL
Devenir famille d’accueil⁷, c’est choisir d’offrir un foyer chaleureux et stable à un·e enfant ou un·e adulte en situation difficile. Les motivations peuvent varier : partager son amour et sa bienveillance, offrir un avenir meilleur à une personne vulnérable, ou simplement répondre à un besoin d’aider.
Ce rôle est ouvert à toutes les familles, qu’elles soient monoparentales, en couple lesbien, gay, hétérosexuel, ou non binaire, avec ou sans enfants. L’essentiel est de garantir un cadre sécurisant et aimant.
A noter : on ne devient pas les parents légaux des enfants que l’on accueille. Il s’agit ici d’une procédure temporaire d’aide envers un·e enfant.
Critères pour Devenir Famille d’Accueil :
- Avoir au moins 18 ans.
- Fournir un certificat de bonne vie et mœurs modèle II.
- Disposer d’un logement adapté avec suffisamment d’espace pour accueillir la personne dans de bonnes conditions.
- Être en mesure d’offrir un cadre qui permette à la personne accueillie de se construire et de s’épanouir.
Nous vous invitons à vous référer sur le site de Parentia, si vous souhaitez avoir plus d’informations sur comment devenir Famille d’Accueil :
La santé des enfants des couples lesbiens
Contrairement à certaines idées reçues, le fait pour un enfant d’être élevé par deux mères ne présente aucun désavantage. En réalité, plusieurs recherches suggèrent qu’il n’existe pas de différence significative entre les enfants issus de familles homoparentales et ceux issus de familles hétéroparentales.
Comme le souligne Éric Feugé, professeur au Département de psychologie de l’UQAM⁸ :
« Depuis une quarantaine d’années, plusieurs études se sont penchées sur cette question et leurs conclusions sont les mêmes : il y a plus de ressemblances que de différences entre les enfants des familles homoparentales et ceux des familles hétéroparentales. »
La Transparentalité
Pour toutes les questions et informations concernant la transparentalité, nous vous invitons à prendre contact avec Genres Pluriels, association de soutien et de défense des droits des personnes transgenres/aux genres fluides et intersexes.
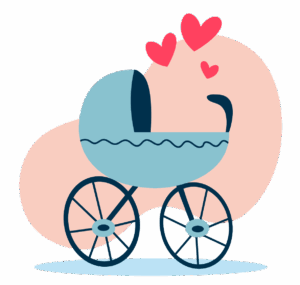
Sites :
- Site Homoparentalité : association belge de (futurs) parents LGBTQIA+ et de leurs enfants.
- Site Direction de l’adoption en FWB
Dossiers :
- Dossier Homoparentalités sur le site de Born in Brussels
- Dossier “l’adoption de A à Z” de l’ASBL Tels Quels
- Brochure “Adoption Internationale” du Service Public Fédéral Justice
Livres :
- Faire Famille Autrement, de Gabrielle Richard
- Mère.s : petit guide de la maternité lesbienne, de Léa Cayrol
- Mes deux mamans, de Bernadette Green et Anna Zobel
- Allié.e – guide de la PMA et de l’Homoparentalité à destination de l’entourage des couples lesbiens, de Léa Cayrol
- Redéfinir la gestation pour autrui, de Marie Dry
- Gosses d’homos – Récits d’enfants de couples lesbiens, de Kolia Hiffler Wittkowsky
Podcasts :
- Prenons un café : “Episode #88 – Léa – La maternité lesbienne”
- Du coming out à faire famille : Quouïr #1 – Karell & Emilie
Vidéos :
- Vidéo Pose ta Q – La PMA
- Vidéo : “Océan, faire famille hors du schéma traditionnel” (saison 3)
¹Loi relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes – Loi du 6 juillet 2007
¹Procréation médicalement assistée – Encadrement législatif en Belgique. Site de l’Institut Européen de Bioéthique
¹Filiation de la coparente : une bonne nouvelle pour les couples lesbiens!, sur le site notaire.be
¹Coparentalité : les lesbiennes ne devront plus adopter l’enfant de leur compagne, Le vif
²Filiation de la coparente : une bonne nouvelle pour les couples lesbiens !, notaire.be
³Le site de la CHC Groupe : La fécondation in vitro (FIV)
⁴GPA – Etat des lieux en Belgique. Sur le site du Conseil des femmes Francophones de Belgique
⁴La gestation pour autrui, du site Actualité du droit belge
⁵Dossier “Adoption” sur le site du Service Public Fédéral Justice. Également via ce lien
⁶Dossier “Adoption internationale” sur le site du Service Public Fédéral Justice
⁷Placement familial : devenir famille d’accueil, est-ce pour moi ? sur le site de Parentia
⁸La réalité des familles LGBTQ+, dossier de Naître et grandir
